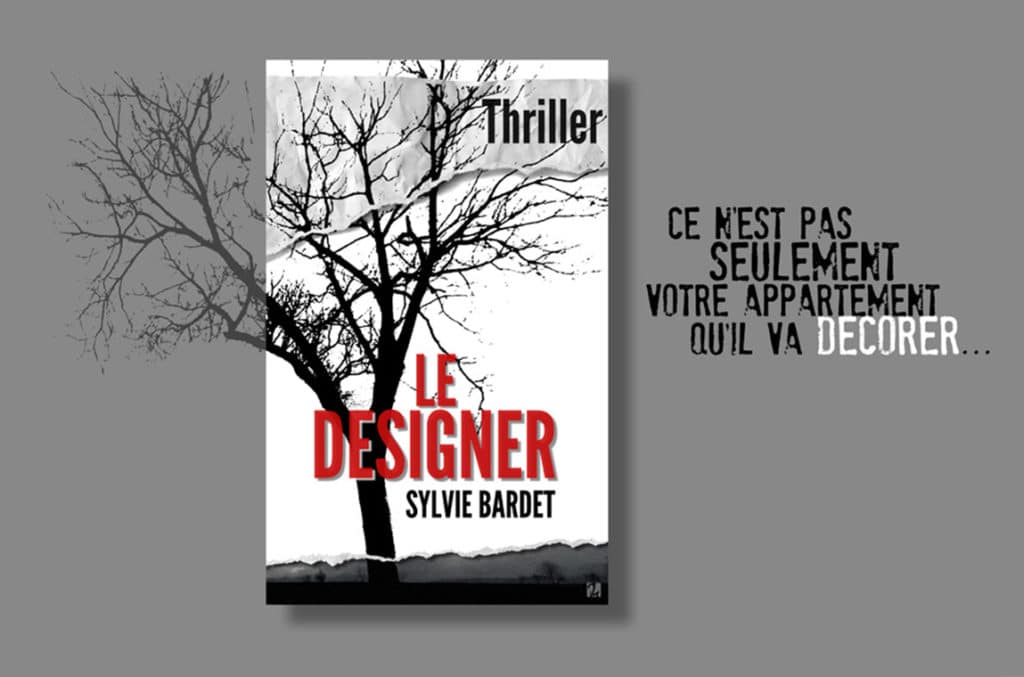
Mon lectorat me demande souvent quelles sont les coulisses d’un roman.
Pourquoi écrire ce livre plutôt qu’un autre ?
Comment l’avez-vous commencé, terminé ?
Quels sont les outils, les mécanismes qui permettent la construction de l’intrigue et de la trame pour que le suspense tienne jusqu’au bout ?
Je vais répondre dans cette série d’articles à venir en commençant par le processus d’écriture de mon second roman: Le Designer.
Lors d’un dîner il y a bien longtemps, un voisin de table – marié depuis vingt ans – m’a confié s’être retrouvé face à une terrible tentation lors d’un voyage à l’étranger. Afin de ne pas céder aux avances d’une créature de rêve qui voulait l’entraîner dans son lit, il s’est, je cite: « tapé la tête contre un mur » pour résister à son désir.
Honorable, mais un peu… anachronique, non?
Ce type de situation, pardonnable, aurait à mon humble avis mérité d’être vécu.
— Mais pourquoi résister ? lui avais-je alors demandé en trempant une carotte rectangulaire dans une sauce bicolore.
— Pour que ma femme ne puisse jamais me reprocher l’adultère.
Certes, cela a fonctionné, mais la liste de reproches – longue comme les rouleaux de la Torah – que sa tendre épouse aimait lui dérouler en public aurait largement noyé dans la multitude de ses ressentiments une banale infidélité d’un soir.
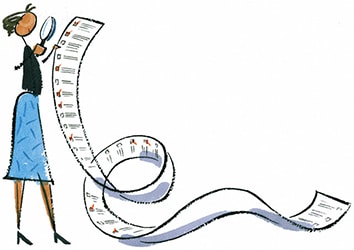
En rentrant chez moi avec Paquito (mon fidèle vieux vélo qui m’a toujours ramenée, pas saine mais sauve, dans les états d’ivresse les plus avancés), je me suis demandé quelle situation, au XXIe siècle dans un pays démocratique, forcerait un individu ordinaire à résister au désir au point d’en mourir ?
L’époque de Julien Sorel étant révolue, et l’homosexualité banalisée, il ne me restait pas grand-chose, voire rien pour mettre mon personnage dans une telle situation : celle de l’amour impossible.
C’est alors qu’une ampoule a grésillé au-dessus de ma tête lorsque je me suis posé la bonne question :
De quelle personne valait-il mieux ne jamais tomber amoureux ?
Mais oui bien sûr !
La réponse est dans le roman.
Impossible de vous la révéler ici sous peine de spoiler l’intrigue.
Il n’empêche, je peux quand même développer un tantinet.
Cette femme, Anna, dont Henry va s’éprendre, possède une caractéristique très spéciale qui va pousser notre antihéros, un profileur renommé et névrosé, au bord du gouffre et de la désespérance létale.
Pauvre Henry ! Quelle idée aussi de tomber amoureux de la seule femme qu’il ne fallait jamais approcher. Surtout dans des circonstances aussi dangereuses.
On ne choisit pas, paraît-il.
Cupidon aime parfois nous empaler, contre toute logique, aux grilles acérées de la tentation et confier nos sentiments aux créatures que notre seule existence indiffère au plus haut point.
C’est un sacré farceur, cet enfoiré !

Un roman a besoin d’une colonne vertébrale, un fil invisible avec un thème universel autour duquel l’intrigue va pouvoir se former.
Le Designer, vous l’aurez compris, est un thriller sur la tentation, mais pas seulement, c’est aussi un roman sur le combat acharné que va mener un homme pour échapper à son statut de victime.
Il me fallait donc un environnement adapté aux tourments du personnage.
La ville dans laquelle Henry travaille rappelle celle de Vancouver, avec ses pluies incessantes et ses flots démontés :
Je regagne le centre-ville en longeant l’océan.
Mes essuie-glaces luttent à plein régime. Vingt jours d’averses sans éclaircies ! Les nuages rejetés par la mer et bloqués par les montagnes déversent sans répit leur frustration sur la mienne. Ton visage flashe sur mon pare-brise.
Ford m’attend sous l’escalier de secours à l’arrière du restaurant dans lequel il travaille.
Je discerne sa silhouette imperméable et la fumée qui s’en échappe sous les trombes d’eau qui inondent la ruelle mal éclairée. Il remonte sa capuche, puis s’engouffre côté passager.
Une odeur de tabac froid et de graisses alimentaires me sort de ma torpeur.

Le village de son enfance, en revanche, est moyenâgeux, chargé d’histoire ; on est obligé de le situer en France ou quelque part au fin fond de l’Europe délaissée.
On ne se sait jamais dans quel pays il se trouve.
La confusion des lieux accentue celle qui embrume l’esprit de notre personnage.
Saint Dix est un village médiéval entouré de collines foncées, de sapins vert sombre et de cascades accidentées. Le paysage est volcanique et la pierre de lave, de couleur gris clair qui s’assombrit avec le temps, utilisée pour bâtir le village et les bourgs alentours, rend les demeures austères, obscures et peu accueillantes.
Les légendes sont nombreuses, et celle du Roc des Pluies Noires suppliciait dans mes cauchemars les protagonistes de cette sinistre histoire. Elle raconte qu’au douzième siècle, une pluie noire, qui aurait teint la pierre de la région, s’est abattue sur le Roc le jour où ont été découverts, dans la crypte sous l’église, les corps de dizaines d’enfants disparus. Le curé a été lynché par les habitants et les pluies abondantes qui tombent depuis sur Saint Dix, seraient les larmes mêlées de terre des victimes qui pleurent pour l’éternité leurs destins brisés.
Le ton est donné.
Le premier chapitre décrit son enfance difficile dans cet obscur environnement : il se fait régulièrement tabasser par les frères Sourdey, « deux costauds bedonnants du hameau d’à côté qui ont tout de suite vu en [lui] un gibier prometteur pour l’avenir de leurs escapades sadiques. »
Enfant, j’ai moi-même été cognée à plusieurs reprises par des garçons mal éduqués.
J’ai inventé le personnage très attachant de Mme Atkins pour donner à Henry l’amour et le soutien que tout gamin devrait avoir à cet âge-là.
Cette femme d’une bonté sans limites est devenue, d’une certaine façon, un souvenir fabriqué, une éclaircie providentielle dans ma mémoire assombrie par des années de difficultés.
Sans [Mme Atkins], les caractéristiques erronées de mes définitions hâtives sur la grisaille du monde n’auraient jamais été modifiées.
L’identité du tueur en série se devine rapidement et se confirme dès la page 80.

C’est volontaire bien sûr.
J’ai pris un énorme risque en faisant ce choix, vous vous en doutez bien. Notamment le risque de passer pour une abrutie incapable de construire une intrigue correctement.
Le Designer n’est pas comme Signes, un roman policier avec une enquête et un coupable démasqué à la fin.
Ici, la divulgation du tueur n’est pas le sujet.
Le Designer est un thriller psychologique.
Le personnage principal va se retrouver dans une situation dramatique dont l’inextricable résolution va l’enfoncer jusqu’aux portes de l’enfer.
Le récit est sombre, très sombre, c’est du noir profond à saper le moral d’une jeune mariée qui vient de gagner au loto !

Dès le chapitre 2, on entre dans le vif du sujet.
Henry est maintenant adulte, coincé dans une histoire d’amour impossible qui le consume et le détruit à petit feu. Un funeste malaise le gagne lors d’un dîner tendu :
Il brûle une cigarette, puis éteint l’allumette en soufflant dans ma direction.
Je n’arrive pas à comprendre l’expression sur son visage, il est fermé, mais le terrible pressentiment qui me glace le dos, lui, est parfaitement explicite.
Quand j’écris un roman, je connais toujours le début, et la fin.
J’expliquerai ce processus plus en détail dans mon prochain article.
En revanche, mis à part quelques balises importantes posées ici et là (les coups de théâtre, la signature du tueur), je ne sais pas ce qui va se passer.
J’ai toujours détesté les plans, que ce soit dans une dissertation à l’école, ou maintenant.
Aucune vie ne peut se contrôler, s’organiser, ni se dérouler comme on l’avait prévue.
Que devient la magie de l’écriture quand tout est déterminé à l’avance ?

Dans le roman, il existe une scène où Henry quitte le centre du village pour respirer et marcher seul en pleine campagne.
Il ne sait pas où il va.
Moi non plus !
Le blocage sur cette page a duré un certain temps.
Je me souviens lui avoir posé la question :
– Henry, où veux-tu aller ? Que veux-tu faire maintenant ?
Je coupe sans réfléchir par la clairière des Tonnelles. Les hautes herbes qui la recouvrent m’obligent à ralentir. Je m’arrête là où le corps d’Adèle se trouvait dans ma mémoire.
Et voilà ! Lui seul pouvait savoir où il devait se rendre.
L’empathie avec mon personnage, avec son histoire et son environnement est telle que mon point de vue se dissout au profit du sien, au profit de tout. Je suis Henry, je suis le tueur et ses pensées nauséabondes, je suis le vent qui souffle pour pouvoir le décrire, je suis le silence assourdissant qui fait hurler nos tourments, je suis le chat qui s’endort au coin du feu.
N’est-ce pas là une métaphore de ce que nous sommes réellement ? L’infime et magnifique partie d’un tout, que l’on s’efforce pourtant d’ignorer au profit d’une vie conditionnée, superficielle et dépourvue de sens…
Après trois heures de route difficile, la pluie faiblit enfin.
La fatigue et le stress me conseillent de faire une pause. Je m’arrête dans une station-service, j’en profite pour faire le plein. Le café a un goût de plastique, une famille avec deux enfants mange des sandwichs en forme de triangle. Même si ce schéma de vie m’a toujours rebuté, je donnerais cher pour être à leur place. Mes yeux sont recouverts d’un voile permanent, celui macabre et crasseux de la misère humaine. Les parois de l’optimisme sont lisses, glissantes, je ne peux m’accrocher à rien.
Sans cette magie, sans cette trame qui se construit souvent malgré moi, je cesserais d’écrire.
Votre processus d’écriture est probablement différent du mien.
Je connais des écrivains incapables de finir leur roman sans un plan super structuré.
Il n’y a pas de méthode meilleure qu’une autre.
Utilisez celle qui vous convient le mieux.
Et si vous n’en avez pas, écrivez tous les jours, peu importe si c’est bien ou non, mais écrivez.


